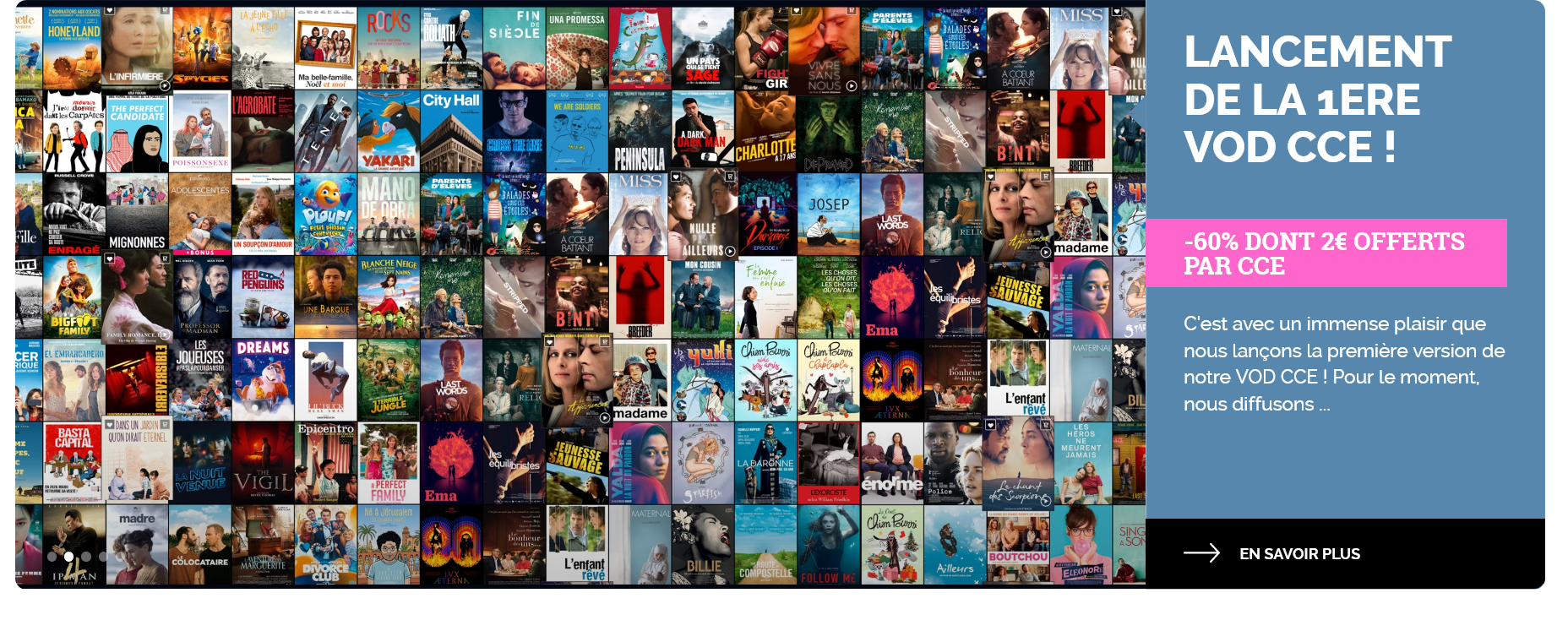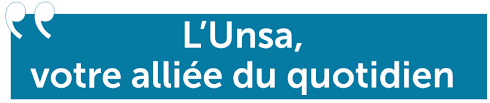Le ministère vient de communiquer les résultats des évaluations nationales CP/CE1/6e. Il en fait l’instrument de la mesure de l’impact de la crise sanitaire et du confinement sur les acquis des élèves. Un point est indiscutable et tristement sans surprise : la crise n’a pas affecté les élèves de manière égale et ce sont les plus fragiles socialement et scolairement qui ont le plus souffert.
Snep UNSA

13 novembre 2020
Quels enseignements tirer des évaluations nationales ?
Des évaluations toujours contestables
Proposées pour la troisième année consécutive, ces évaluations restent bien peu utiles aux enseignants et leurs résultats sont toujours à manipuler avec prudence. Le protocole et la façon dont elles sont construites ne permettent pas de confirmer ou invalider un pilotage qu’il soit national ou local. De plus, elles ne permettent pas aux enseignants de mieux mettre en œuvre une aide adaptée aux élèves qui en auraient besoin, les résultats arrivant début octobre. On reste donc sur un protocole lourd et coûteux avec une plus-value inexistante. Le seul intérêt, mais il ne répond qu’aux attentes des politiques, est de permettre de comparer les résultats d’une année à l’autre et d’identifier d’éventuelles évolutions. Reste néanmoins à en identifier les causes. Et là, chacun avance ses pistes d’interprétation en fonction de ses intérêts ou de ses convictions.
Un protocole qui s’améliore très lentement
Le ministère croit en ces évaluations, il y passe du temps, communique sur ce qu’elles apportent ou prouvent (la plupart du temps, rien que l’on ne sache déjà). Il prend néanmoins en compte les retours du terrain. Les évaluations s’améliorent, mais très lentement. Le protocole est moins lourd, les outils de connexion plus performants, mais le satisfecit du terrain n’est pas dithyrambique : seulement 36 % des enseignants (26 % en 2018) déclarent par exemple que l’infographie proposée leur a été utile pour la communication avec les parents.
Des résultats en cycle 2 qui ne nous apprennent pas grand-chose
Globalement, les résultats sont un peu moins bons à la rentrée 2020 par rapport à l’année passée, le confinement a évidemment empêché les élèves de CP et de CE1 de profiter pleinement d’un tiers de l’année scolaire. Pour des élèves qui n’ont que 3 ou 4 ans d’école derrière eux, il n’y a pas de surprise. La dynamique que la Depp avait remarqué l’an passé lors de l’évaluation de mi-parcours en CP a été annihilée par le confinement. Pour les mathématiques, la résolution de problèmes et l’exercice de positionnement des nombres sont ceux qui sont les plus chutés, que ce soit au CP ou au CE1.
L’adhésion des enseignants reste à gagner
En début de CP, pour l’ensemble des exercices, le taux d’accord des enseignants avec la pertinence des exercices proposés varie de 55 % à 79 %. Seul l’exercice de placement des nombres sur une droite numérique recueille un taux nettement inférieur (24 %), bien qu’en hausse par rapport à 2018 où il était à 15 %, on peut se demander pourquoi le ministère le maintient. Le fait que beaucoup d’exercices soient jugés moins pertinents en 2020 qu’en 2018 interroge quand même sur la façon dont le ministère travaille, que ce soit pour les CP (5 exercices jugés moins pertinents sur 12) ou les CE1 (9 exercices jugés moins pertinents sur 14).
Le satisfecit du terrain est plus quantitatif que qualitatif : la durée de passation est mieux approuvée par les enseignants entre 2018 et 2020 et l’outil de saisie des résultats s’est également amélioré.
Les enseignants s’interrogent, à juste titre, sur le fait de mettre en difficulté les élèves les plus fragiles dès le début de l’année avec des évaluations nationales dénuées de bienveillance alors qu’ils sont plus à même de mettre en œuvre des protocoles plus souples et à visée formative.
Les élèves de l’Éducation prioritaire, grandes victimes du confinement
Les grandes différences de résultats entre éducation prioritaire (EP) et hors éducation prioritaire apparaissent surtout en compréhension. Ce n’est pas une surprise, la maîtrise de la langue orale étant meilleure dans les populations les plus favorisées. Et pourtant, c’est sur la phonologie, et pas la compréhension, que le ministère demande que les enseignants mettent l’accent avant l’entrée en élémentaire. En mathématiques, c’est en résolution de problèmes que les écarts se creusent le plus, à nouveau les compétences nécessitant une démarche de raisonnement devraient être mises en avant, ce qui n’est malheureusement pas le cas lorsque tout tourne autour des fondamentaux. Les résultats en CE1 vont dans le même sens.
Les écarts se sont fortement creusés entre EP et hors EP depuis les évaluations de mi-parcours de février 2020 en CP, atteignant en moyenne 5 à 6 points. Les populations les plus éloignées de l’École sont bien celles qui en ont le plus besoin. Le travail à distance était complexe et souvent ce sont ces familles qui ont hésité le plus longtemps à envoyer leurs enfants de nouveau à l’école à la fin du confinement.
Un grand besoin de mixité
Le rapport sur les évaluations de sixième montre clairement les dégâts de la non-mixité sociale et de l’absence d’une politique soutenue contre les ségrégations scolaires. Dans les collèges les plus favorisés socialement, les taux de maîtrise s’élèvent à 95,9 % en français et 86,5 % en mathématiques alors que dans les établissements les moins favorisés, les taux de maîtrise sont respectivement de 75,3 % et de 50,3 %, pour le français et les mathématiques(*). La concentration d’élèves en difficultés sociales et scolaires ne peut que compliquer leurs apprentissages. Les enseignants se retrouvent à devoir gérer des difficultés multifactorielles qui pourraient être moins aiguës si une réelle politique de mixité était mise en œuvre.
Évaluations sixième : des explications à prendre avec des pincettes
Les résultats aux évaluations 6e sont meilleurs cette année qu’en 2019, aussi bien en mathématiques qu’en français. Cependant lorsque l’on regarde de plus près les mathématiques qui sont largement moins réussies que le français, on remarque que de nombreux exercices de mathématiques demandent un niveau de lecture assez performant. Ainsi, si les élèves ont des problèmes de compréhension, ils ne peuvent que chuter en mathématiques sans que l’on puisse savoir où en est réellement leur maîtrise de cette matière. Les nombreux pièges, que la Depp appelle des distracteurs, ne font que compliquer la réelle évaluation du niveau des élèves. On peut donc craindre un énième plan mathématiques alors que la compréhension de ce qui est demandé peut être le nœud du problème.
Le nouvel exercice sur la fluence introduit cette année n’a pas bien été réussi mais devoir oraliser rapidement un texte inconnu lors d’une telle évaluation ne peut qu’entraîner du stress chez beaucoup d’élèves et fausser leurs réelles capacités. À nouveau, on peut craindre un plan fluence qui serait éloigné de ce qu’est vraiment la lecture : comprendre.
Des élèves en progrès, mais pourquoi ?
Enfin, il est assez regrettable d’entendre le DGesco se féliciter des dispositifs mis en place au printemps dernier pour les futurs sixièmes ou les vacances apprenantes, pour justifier l’amélioration des résultats d’une année sur l’autre en début de sixième malgré la situation sanitaire. Ces dispositifs ont concerné très peu d’élèves. Il est sans doute plus probable que le confinement ait permis aux futurs sixièmes d’améliorer leur utilisation du clavier de l’ordinateur. À souligner aussi que la mise en œuvre des séquences était un peu plus simple et que les équipes ont été sans doute plus vigilantes, averties des écueils de la passation de l’an dernier qui avaient rendu les résultats largement inutilisables.
Si les effets du confinement sont au final très mesurés pour l’immense majorité des élèves, les enseignants, eux, savent bien pourquoi : garder le lien avec leurs élèves, leur faire aimer l’école, les intéresser, les faire réfléchir, leur donner des habitudes de travail. Cela prend du temps, demande de l’énergie et une confiance réciproque. Si cette confiance existe réellement entre les enseignants et leurs élèves, c’est loin d’être le cas entre les enseignants et le ministère, ce qui est problématique à l’ère de l’école de la confiance.
(*) Extrait de la note de la Depp sur les évaluations 6e - p. 31
Proposées pour la troisième année consécutive, ces évaluations restent bien peu utiles aux enseignants et leurs résultats sont toujours à manipuler avec prudence. Le protocole et la façon dont elles sont construites ne permettent pas de confirmer ou invalider un pilotage qu’il soit national ou local. De plus, elles ne permettent pas aux enseignants de mieux mettre en œuvre une aide adaptée aux élèves qui en auraient besoin, les résultats arrivant début octobre. On reste donc sur un protocole lourd et coûteux avec une plus-value inexistante. Le seul intérêt, mais il ne répond qu’aux attentes des politiques, est de permettre de comparer les résultats d’une année à l’autre et d’identifier d’éventuelles évolutions. Reste néanmoins à en identifier les causes. Et là, chacun avance ses pistes d’interprétation en fonction de ses intérêts ou de ses convictions.
Un protocole qui s’améliore très lentement
Le ministère croit en ces évaluations, il y passe du temps, communique sur ce qu’elles apportent ou prouvent (la plupart du temps, rien que l’on ne sache déjà). Il prend néanmoins en compte les retours du terrain. Les évaluations s’améliorent, mais très lentement. Le protocole est moins lourd, les outils de connexion plus performants, mais le satisfecit du terrain n’est pas dithyrambique : seulement 36 % des enseignants (26 % en 2018) déclarent par exemple que l’infographie proposée leur a été utile pour la communication avec les parents.
Des résultats en cycle 2 qui ne nous apprennent pas grand-chose
Globalement, les résultats sont un peu moins bons à la rentrée 2020 par rapport à l’année passée, le confinement a évidemment empêché les élèves de CP et de CE1 de profiter pleinement d’un tiers de l’année scolaire. Pour des élèves qui n’ont que 3 ou 4 ans d’école derrière eux, il n’y a pas de surprise. La dynamique que la Depp avait remarqué l’an passé lors de l’évaluation de mi-parcours en CP a été annihilée par le confinement. Pour les mathématiques, la résolution de problèmes et l’exercice de positionnement des nombres sont ceux qui sont les plus chutés, que ce soit au CP ou au CE1.
L’adhésion des enseignants reste à gagner
En début de CP, pour l’ensemble des exercices, le taux d’accord des enseignants avec la pertinence des exercices proposés varie de 55 % à 79 %. Seul l’exercice de placement des nombres sur une droite numérique recueille un taux nettement inférieur (24 %), bien qu’en hausse par rapport à 2018 où il était à 15 %, on peut se demander pourquoi le ministère le maintient. Le fait que beaucoup d’exercices soient jugés moins pertinents en 2020 qu’en 2018 interroge quand même sur la façon dont le ministère travaille, que ce soit pour les CP (5 exercices jugés moins pertinents sur 12) ou les CE1 (9 exercices jugés moins pertinents sur 14).
Le satisfecit du terrain est plus quantitatif que qualitatif : la durée de passation est mieux approuvée par les enseignants entre 2018 et 2020 et l’outil de saisie des résultats s’est également amélioré.
Les enseignants s’interrogent, à juste titre, sur le fait de mettre en difficulté les élèves les plus fragiles dès le début de l’année avec des évaluations nationales dénuées de bienveillance alors qu’ils sont plus à même de mettre en œuvre des protocoles plus souples et à visée formative.
Les élèves de l’Éducation prioritaire, grandes victimes du confinement
Les grandes différences de résultats entre éducation prioritaire (EP) et hors éducation prioritaire apparaissent surtout en compréhension. Ce n’est pas une surprise, la maîtrise de la langue orale étant meilleure dans les populations les plus favorisées. Et pourtant, c’est sur la phonologie, et pas la compréhension, que le ministère demande que les enseignants mettent l’accent avant l’entrée en élémentaire. En mathématiques, c’est en résolution de problèmes que les écarts se creusent le plus, à nouveau les compétences nécessitant une démarche de raisonnement devraient être mises en avant, ce qui n’est malheureusement pas le cas lorsque tout tourne autour des fondamentaux. Les résultats en CE1 vont dans le même sens.
Les écarts se sont fortement creusés entre EP et hors EP depuis les évaluations de mi-parcours de février 2020 en CP, atteignant en moyenne 5 à 6 points. Les populations les plus éloignées de l’École sont bien celles qui en ont le plus besoin. Le travail à distance était complexe et souvent ce sont ces familles qui ont hésité le plus longtemps à envoyer leurs enfants de nouveau à l’école à la fin du confinement.
Un grand besoin de mixité
Le rapport sur les évaluations de sixième montre clairement les dégâts de la non-mixité sociale et de l’absence d’une politique soutenue contre les ségrégations scolaires. Dans les collèges les plus favorisés socialement, les taux de maîtrise s’élèvent à 95,9 % en français et 86,5 % en mathématiques alors que dans les établissements les moins favorisés, les taux de maîtrise sont respectivement de 75,3 % et de 50,3 %, pour le français et les mathématiques(*). La concentration d’élèves en difficultés sociales et scolaires ne peut que compliquer leurs apprentissages. Les enseignants se retrouvent à devoir gérer des difficultés multifactorielles qui pourraient être moins aiguës si une réelle politique de mixité était mise en œuvre.
Évaluations sixième : des explications à prendre avec des pincettes
Les résultats aux évaluations 6e sont meilleurs cette année qu’en 2019, aussi bien en mathématiques qu’en français. Cependant lorsque l’on regarde de plus près les mathématiques qui sont largement moins réussies que le français, on remarque que de nombreux exercices de mathématiques demandent un niveau de lecture assez performant. Ainsi, si les élèves ont des problèmes de compréhension, ils ne peuvent que chuter en mathématiques sans que l’on puisse savoir où en est réellement leur maîtrise de cette matière. Les nombreux pièges, que la Depp appelle des distracteurs, ne font que compliquer la réelle évaluation du niveau des élèves. On peut donc craindre un énième plan mathématiques alors que la compréhension de ce qui est demandé peut être le nœud du problème.
Le nouvel exercice sur la fluence introduit cette année n’a pas bien été réussi mais devoir oraliser rapidement un texte inconnu lors d’une telle évaluation ne peut qu’entraîner du stress chez beaucoup d’élèves et fausser leurs réelles capacités. À nouveau, on peut craindre un plan fluence qui serait éloigné de ce qu’est vraiment la lecture : comprendre.
Des élèves en progrès, mais pourquoi ?
Enfin, il est assez regrettable d’entendre le DGesco se féliciter des dispositifs mis en place au printemps dernier pour les futurs sixièmes ou les vacances apprenantes, pour justifier l’amélioration des résultats d’une année sur l’autre en début de sixième malgré la situation sanitaire. Ces dispositifs ont concerné très peu d’élèves. Il est sans doute plus probable que le confinement ait permis aux futurs sixièmes d’améliorer leur utilisation du clavier de l’ordinateur. À souligner aussi que la mise en œuvre des séquences était un peu plus simple et que les équipes ont été sans doute plus vigilantes, averties des écueils de la passation de l’an dernier qui avaient rendu les résultats largement inutilisables.
Si les effets du confinement sont au final très mesurés pour l’immense majorité des élèves, les enseignants, eux, savent bien pourquoi : garder le lien avec leurs élèves, leur faire aimer l’école, les intéresser, les faire réfléchir, leur donner des habitudes de travail. Cela prend du temps, demande de l’énergie et une confiance réciproque. Si cette confiance existe réellement entre les enseignants et leurs élèves, c’est loin d’être le cas entre les enseignants et le ministère, ce qui est problématique à l’ère de l’école de la confiance.

Les divers scandales mis en lumière initialement par madame la Ministre Oudéa Castéra (Stanislas et le séparatisme scolaire), les commissions d'enquêtes sur les violences aux élèves dans des établissements scolaires ont permis à la presse de s'emparer de sujets traités jusque là dans un petit périmètre. La mise en place des contrôles dans les établissements privés sous contrat fait ressortir ce que beaucoup d'intervenants intérieurs (enseignants, inspecteurs, recteurs, ministres) savaient : des pratiques de directeurs, de cadres "éducatifs" et parfois d'enseignants fonctionnaires ou contractuels, peut conforme aux Lois de la République. En revanche une de ses pratiques, le séparatisme scolaire notamment est le fruit du travail de l'association Secrétariat général de l'enseignement catholique. La déformation de la loi Debré (1959), puis le contenu de la loi Gueurmeur (1976), puis les accords Lang Cloupet et l'accord Pap Ndiaye SGEC ont été initiés et sont au bénéfice de cette association qui cherche à se prendre pour un ministère bis de l'éducation nationale. Et quand le travail de la presse dérange trop, le nouveau président de cette association, le fait savoir par un menace explicite, selon un article ( ici ) N'ayant pas d'intérêts légaux à agir, cette possible plainte pourrait ne même pas se concrétiser. Voir sur le site de la HATVP la raison d'être de cette association. Quant à ses statuts et ses comptes financiers, ils seraient intéressants de s'y intéresser. Quoi qu'il en soit le Snep UNSA continuera de participer à la valorisation du travail et du statut de ses mandants les enseignants fonctionnaires ou contractuels affectés par l'autorité administrative dans des murs privés. La mission de service public des enseignants de l'éducation nationale ne se discute pas. Le Snep UNSA continuera de soutenir le travail de la presse, contre pouvoir, élément indispensable d'un Etat de droits. Que celle-ci dérange, nous le comprenons puisque le travail des enseignants de l'éducation nationale contribue au ciment de la République (voir code de l'éducation) Contact presse : Franck Pécot 06 52 60 83 11

Cher(e)s collègues, Comme vous avez eu l'occasion de le remarquer, les voeux qui nous sont adressés par monsieur le Ministre sont laudateurs ( ICI ). "il est des femmes et des hommes qui, sans bruit, font reculer ces ténèbres. Ils n’occupent pas les plateaux de télévision, ils n’annoncent pas de ruptures spectaculaires. Ils allument, patiemment, les lumières de l’esprit humain. Ces femmes et ces hommes, ce sont principalement vous les professeurs, et tous ceux qui, avec vous, font l’École." Le 18 décembre 2026, nous étions reçus au ministère pour que la lumière, ministérielle, par des règles claires et applicables partout, permettent aux enseignants des établissements privés sous contrat d'exercer leur métier au quotidien sereinement. Les contrôles de l'activité des directeurs, en premier lieu, se mettent en place. Il était temps car les enseignants, eux, voyaient, voient et verront encore leurs activités contrôlées et c'est bien normal. Il manque toutefois une conclusion à ces voeux, la juste rémunération du travail réalisé et les perspectives d'amélioration pour l'avenir. Nous avons besoin d'être une profession rassemblée pour pouvoir peser sur nos conditions statutaires comme nos salaires. Rendez-vous au mois de décembre 2026, pour désigner des représentants œuvrant pour une profession unie qui avance. Loin des clivages, entretenus, agissez à votre niveau en adhérent à un syndicat qui peut vous représenter à l'Éducation nationale auprès de votre employeur. Enfin, en ce début d’année 2026, permettez-nous de vous adresser nos vœux les plus sincères : que cette nouvelle année soit porteuse de santé, de sérénité et de reconnaissance pour votre engagement professionnel au service de l’École.

Face à l'extraordinaire activité de lobbying déployée par le SGEC depuis les années 1970 afin de s'attribuer toujours plus de financement public (et se servir au passage), le Snep UNSA partage la position d'organisations demandant le respect de la loi et la promotion des valeurs de la République. Des subventions publiques qui font le bonheur de lobbyistes ? En effet, le SGEC, outil de lobbying de la conférence des évêques, ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, mais d'une forme d'impôt pris sur les établissements privés sous contrat, environ 100 € par élève et par année. 200 millions d'euros servent donc chaque année pour déformer la carte scolaire en fonction d'enjeux dont le caractère unitaire, c'est-à-dire Républicain est loin d'être établi. 200 millions ne sont pas versés, en salaire, aux personnels non enseignants et/ou ne sont pas utilisés pour améliorer les conditions de travail de tous, les conditions d'enseignement aux élèves. Les personnels pénalisés ? À noter parmi ces organisations : les syndicats d'enseignants. Rappelons que la profession des enseignants fonctionnaires ou contractuels de l'éducation nationale (et du ministère de l'Agriculture) est la seule profession de l'État à connaitre la division statutaire. Pour un même métier : deux statuts Les mêmes obligations de services pour tous, mais les fonctionnaires et contractuels affectés dans les murs privés ont des droits en moins (salaire, retraite, droit à formation, droit à mobilité, qualité de vie au travail non pris en compte pleinement par l'employeur) Bétharram, cas d'école ? L'annonce de la fermeture de l'établissement qui a permis au scandale des violences en milieu scolaire d'éclater sera peut-être l'occasion pour l'État de rependre la main sur les ouvertures et fermetures de classe. Jusque-là cette prérogative régalienne était visée avec une certaine efficacité par le SGEC. Les moyens (dotation horaire et subventions publiques) vont peut-être pouvoir être utilisés davantage au bénéfice des élèves dans le cadre Républicain plutôt que pour alimenter d'autres projets que ceux du Service public de l'éducation ? Contact presse : Franck Pécot 06.52.60.83.11
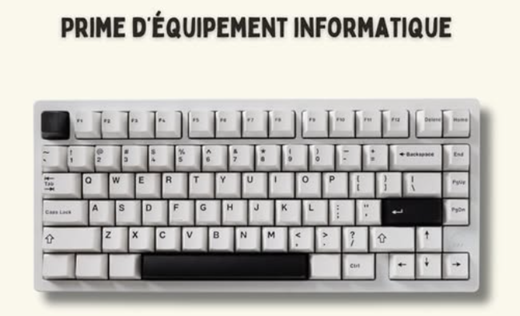
Cette prime de 176 € brut est versée aux bénéficiaires en activité au 1er janvier. Elle est attribuée chaque année aux personnels exerçant à temps complet comme à temps partiel. Bénéficiaires : Enseignants, stagiaires et titulaires (fonctionnaire ou contrat définitif), exerçant des missions d’enseignement Contractuels (maitres délégués) exerçant les missions ci-dessus, sous certaines conditions. Compensation pour les professeurs documentalistes En 2021, nous avions obtenu une revalorisation de leurs indemnités, légèrement supérieure au montant de la prime d’équipement informatique : de 767,10 € à 1 000 € brut pour les profs doc, revalorisée à 2 550 € brut à la rentrée 2023 Dans la mesure où, depuis, plusieurs augmentations sont intervenues notamment pour converger vers les montants de l’Isoe, l’augmentation de l’indemnité de fonction que nous avions obtenue pour ces personnels en 2021 prend tout son sens. Exclus sans solution Restent aussi exclus les DDFPT… s’ils n’exercent pas directement des missions d’enseignement, ainsi que les collègues en congé parental, en disponibilité ou en congé de formation professionnelle au 1er janvier. Un collègue qui prendrait 2 mois de congé parental autour de cette date sera exclu, ce qui est inadmissible. Cela pénalisera encore les femmes qui sont toujours les plus nombreuses à prendre ce congé, ainsi que les hommes qui ont la volonté d’inverser cette tendance. Contractuels, maitres délégués, en CDD et CDI Les personnels contractuels en CDI bénéficient de la prime d’équipement. En CDD, la prime est attribuée pour des contrats d’un an au 1er janvier ou des contrats successifs d’une durée cumulée d’un an, sous réserve que l’interruption entre 2 contrats soit inférieure à 4 mois. Pour le Snep-Unsa, la création de cette prime était une bonne idée qui répondait à une demande forte du terrain. Pourtant, en excluant certains enseignants, un sentiment d’injustice perdure. Le Snep-Unsa va poursuivre l’action jusqu’à obtenir des solutions indemnitaires pour chaque catégorie exclue à ce jour du bénéfice de la prime.

Aujourd’hui, les 140 000 AESH (accompagnant(e) d'élèves en situation de handicap) qui représentent le deuxième métier de l’Education nationale, ont des statuts précarisés et souvent des salaires indécents découlant fréquemment de temps partiel imposés. Dans un contexte de préparation du budget 2026, presque toutes les organisations syndicales du ministère appellent l’Etat à prendre ses responsabilités en offrant aux AESH un véritable statut leur permettant de bénéficier d’une reconnaissance de leurs missions et d’accéder à de nouveaux droits. Mercredi 7 janvier, au Sénat une proposition de loi visant à améliorer le statut des personnels en charge de l'accompagnement individuel des élèves en situation de handicap a été rejetée par la majorité des sénateurs. Sur le fond le Snep UNSA regrette, à ce stade, ce choix politique En effet, accorder le statut de fonctionnaires de catégorie B aux AESH permettrait de professionnaliser le métier en passant par un concours de la fonction publique et d'améliorer l'attractivité de la profession. L'enjeu est de taille : en septembre dernier, près de 50 000 élèves en situation de handicap n'avaient pas d'AESH. Toutefois le projet de loi adopté en commission du Sénat posait des difficultés statutaires conséquentes. En effet le texte soumis en séance à l'ensemble des sénatrices et sénateurs imposait un statut à deux vitesses : le statut de fonctionnaire pour certain(e)s AESH, un maintien en temps que contractuel pour les autres. Cette volonté de diviser la profession des AESH aurait rendu service au SGEC (secrétariat général de l'enseignement catholique) qui aurait eu l'occasion de récupérer des fonds publics et une forme d'emprise sur une partie des AESH. Les sénateurs pourtant majoritairement favorables, par leurs votes, aux enjeux et désirs du SGEC, n'ont pas soutenu cette vision d'une profession divisée statutairement. A moins que cela ne soit que tout simplement, la volonté de laisser dans la précarité une profession peu utile à des parents électeurs qui n'en ont pas besoin des AESH ? Le Snep UNSA réclame un véritable statut de la Fonction publique pour reconnaître le métier d’AESH, pour tous les AESH, des formations adaptées au métier, bref la reconnaissance du travail de celles et ceux qui font aussi vivre l'Ecole pour toutes et tous les élèves. Contact presse : Franck Pécot, 06 52 60 83 11

Le 17 décembre 2025, audience au ministère : Le ministre monsieur Edouard GEFFRAY était représenté par madame Marjorie Koubi, conseillère en charge du dialogue social et des ressources humaines ainsi que Madame Anne Padier Savouroux, conseillère en charge de l’école inclusive, de la santé psychique et physique et du sport et de monsieur Lionel Leycuras, de la sous-direction de l’enseignement privé. Du Snep UNSA et du SnIa-Ipr, le syndicat des inspecteurs d'académie IA-IPR. Les échanges ont porté sur les contrôles dans les établissements privés sous contrat : la vie scolaire, le sport scolaire et la formation professionnelle des agents de l'Etat. Nous avons bien entendu que les organisations Formiris et équivalentes étaient actuellement auditées par la Cour des comptes. Nous avons démontré la nécessité d'un contrôle spécifique par l'inspection générale du ministère. Nous restons en lien avec le ministre, notamment sur ce sujet.

Dans le cadre de ses audiences au ministère de l'Éducation nationale, le Snep UNSA vient vers vous Le Snep UNSA vous interroge au sujet de la situation des formations à la laïcité et à EVAR/EVARS avant d'aller plus loin sur le thème de la démocratie interne à l'établissement privé sous contrat. Vos réponses sur une possible concertation afin d'organiser la rentrée 2026, sur l'existence d'un lieu de vie citoyenne pour les élèves, ... seront aussi portées à notre autorité de tutelle.